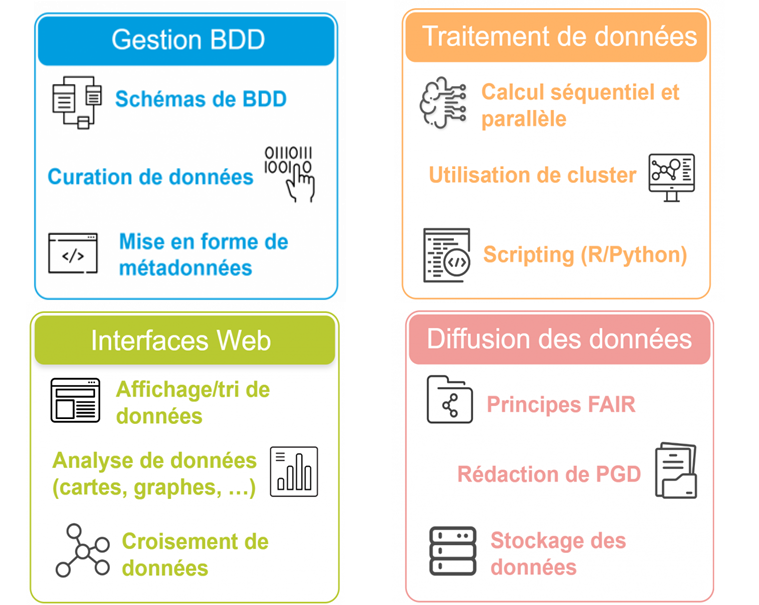EECAR-TR Ecologie de la Restauration, Ingénierie écologique
Thème de recherche - Ecologie de la restauration & Ingénierie écologique
Nos recherches en écologie de la restauration et ingénierie écologique sont axées sur l’identification des processus clés qui limitent la résilience des habitats naturels et semi-naturels impactés par des dégradations anthropiques très diverses (industriels, militaires, agricoles). Les organismes cibles de nos recherches sont les plantes et les arthropodes appréhendés au niveau d’organisation des communautés et des populations y compris leur structuration génétique. Nous nous intéressons plus particulièrement à la restauration de la biodiversité et de la fonctionnalité des écosystèmes terrestres en impliquant les interactions plantes-arthropodes via l’identification d’espèces clés ou ingénieures des écosystèmes.
La finalité opérationnelle de ces recherches est de mieux orienter, accompagner et évaluer les opérations de restauration écologique mises en place dans les écosystèmes terrestres dans des cadres variés (compensation écologique, réduction d’impacts, etc.) tout en produisant de nouvelles connaissances fondamentales en écologie ainsi que des innovations dans le domaine de la restauration et de l’ingénierie écologique.

Exemple de recherches en cours - Impact de la restauration écologique sur l’assemblage des pollinisateurs
Le projet évalue l’impact de deux méthodes de restauration d’écosystèmes herbacés — transfert de foin (RA) et régénération naturelle (RN) — sur l’assemblage des pollinisateurs. Pour cela, on étudie la flore et les interactions plantes-pollinisateurs dans un ancien verger abandonné puis restauré du sud de la France, et participe à l’interprétation des données récoltées dans toute l’Europe sur le sujet (voir ici pour plus de détails sur le sujet à l’échelle européenne ici).
Ainsi, 12 sites (4 RA – régénération assistée par transfert de foin, 4 RN – régénération naturelle, 4 références = pelouses intactes) ont été étudiés via l’échantillonnage des interactions plantes-pollinisateurs et de la flore. Quinze ans après restauration, la composition végétale des sites RA et RN diffère encore de la référence, plus riche en espèces. Sur les sites de référence, Euphorbia seguieriana domine les interactions, majoritairement avec des Coléoptères et Diptères. Sur RA et RN, Galactites elegans, Lobularia maritima et Diplotaxis tenuifolia sont les principales ressources florales. Les pollinisateurs les plus actifs sont les Coléoptères et Hyménoptères sur RN, et également les Diptères sur RA. RN présente la plus forte couverture florale, suivie de RA, grâce à des espèces à grandes fleurs. Le transfert de foin ne permet pas à lui seul de restaurer le réseau plante-pollinisateur, n’améliorant pas suffisamment la composition floristique.

Exemple de recherches en cours - Le ré-ensauvagement
Restaurer les écosystèmes ou ré-ensauvager, quelle est la meilleure approche pour remettre en état un écosystème perturbé par les activités humaines ?
Ces deux approches ont pour ambition la réparation des écosystèmes altérés par les activités humaines, mais les ambitions comme les méthodes employées divergent (lien). Le réensauvagement encourage la libre évolution des écosystèmes sans objectif totalement défini, tandis que la restauration écologique est axée sur le pilotage des processus naturels vers des objectifs à atteindre notamment en termes de biodiversité et de services rendus par les écosystèmes. Clémentine Mutillod explique cette recherche ici et là
Nous avons également étudié l’impact du ré-ensauvagement sur les écosystèmes de pelouse en France en comparant les répercussions sur le milieu de l’introduction d’un mammifère herbivore sauvage, en l’occurrence le cheval de Przewalski, avec celles de la présence de mammifères domestiqués comme les brebis ou les chevaux. Les trois types de pâturage permettent le maintien de la communauté de pelouse souhaitée (E1.51 – Steppes méditerranéo-montagnardes). Cependant, le pâturage par les chevaux gérés « à l’état sauvage » induit une richesse spécifique de plantes et une hétérogénéité plus élevées qu’avec du pâturage ovin. Clémentine Mutillod explique cette recherche ici et là.


Exemple de recherches en cours - Entre béton et bitume, quelle place pour le retour de la nature ?
Si le ré-ensauvagement et la libre expression apparaissent comme des solutions séduisantes pour restaurer nos écosystèmes dans un cadre de changements climatiques et de transition écologique, encore faut-il que la nature soit capable « de faire le job » quand des seuils d’irréversibilité ont été franchis.
Un seuil d’irréversibilité a été défini comme un point à partir duquel un écosystème a été tellement dégradé que ses capacités de résilience ne lui permettent plus de s’autoréparer naturellement pour retourner à son état initial. C’est notamment le cas lors de dégradations lourdes issues d’utilisations militaires, industrielles ou agricoles intensives.
Dans la plaine de Crau, nous réalisons actuellement des expérimentations de restauration écologique pour franchir ces seuils d’irréversibilité notamment via le descellement d’une plaque de béton d’un bâtiment industriel construit dans les années 1970. Ecouter Thierry Dutoit en parler ici. Nos premiers résultats montrent que si le scellement du sol pendant 50 années a bien impacté la majorité des caractéristiques physico-chimiques du sol sub-steppique et sa biodiversité (micro-organismes, pédofaune), la résilience après descellement devrait cependant être plus rapide que pour des sols pollués par des métaux lourds (brulage de munitions) ou déstructurés et hyper-fertilisés (phosphore, potassium) lors de l’exploitation de vergers intensifs.
Dans la plaine de Crau, suite à une fuite d’hydrocarbures et un transfert de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sol, nous avons testé la réintroduction de fourmis moissonneuses (Messor barbarus L.) afin d’accélérer la restauration de la végétation steppique qui préexistait (lien). Après une dizaine d’années, nos résultats ont montré une grande réussite de l’opération avec des résultats très favorables, là où des nids se sont formés suite à la transplantation, notamment sur la fertilité du sol, la biomasse herbacée, la composition et la richesse spécifique de la végétation qui sont alors beaucoup plus proches de la steppe de référence (lien). Thierry Dutoit et Tania de Almeida expliquent cette recherche ici et là.

Exemple de recherches récentes – Restauration et intégration écologique des centrales photovoltaïques
La construction des centrales photovoltaïques a un impact fort et négatif sur la végétation et les organismes associés. Après la construction, une gestion adaptée par fauche ou pâturage peut permettre l’installation des pelouses semi-naturelles et la restauration des fonctions du sol. Nous avons analysé les effets de la construction des centrales et – suite à la construction – l’effet de la présence des panneaux photovoltaïques sur la végétation, la faune et le fonctionnement du sol et les pollinisateurs. En plus, nous avons testé plusieurs techniques de restauration écologique. Le transfert des semences récupérées par aspiration dans une communauté de référence était la méthode la plus prometteuse pour rétablir les pelouses méditerranéennes à Brachypodium retusum mais la présence des panneaux limite leur installation (Lambert et al. 2022). La restauration des fonctionnalités du sol suit celle de la végétation mais avec un vitesse plus faible (Lambert et al. in press). Une boîte à outils issue de l’ancien projet PIESO et destinée aux gestionnaires est disponible: PIESOBOOST 2020. Les différents projets sur cette thématique ont été menés en collaboration étroite avec l’équipe ECOSOM.

Exemple de recherches récentes – Restauration écologique des pelouses montagnardes en Haute Durance
Les travaux de restauration écologique liés à la mise en place d’une nouvelle ligne électrique en Haute Durance ont été réalisés en collaboration avec l’INRAE de Grenoble, le bureau d’étude ECO-MED et RTE. Les recherches sur les techniques de restauration active ont démontré que l’apport de graines via transfert de matériel végétal récolté par une brosseuse de graines avec système d’aspiration améliore significativement l’installation des espèces cibles indicatrices des prairies de référence.
Le semis simultané du blé en tant qu’espèce nurse favorise l’installation de ces espèces (Durbecq et al. 2022). Contre nos attentes initiales, la mise en exclos a eu un effet faible sur l’installation suggérant que les clôtures de protection ne sont pas forcément nécessaires (Durbecq et al. 2021, Durbecq et al. 2023a). L’expérimentation a aussi montré qu’un semis en plusieurs étapes peut favoriser les espèces moins compétitives en les semant avant les espèces dominantes (effets de priorité, Durbecq et al. 2023b). Les analyses sont en cours pour évaluer le déploiement des mesures de restauration à plus grande échelle.

Exemple de recherches récentes - Restaurer pour et par la nature via l’utilisation d’ingénieurs des écosystèmes
Entre restaurer les écosystèmes via des techniques lourdes de génie civil ou laisser-faire la nature, une troisième voie existe, celle d’agir via l’utilisation d’espèces dites « ingénieures des écosystèmes » dont des rôles majeurs sont attendus pour des coûts économiques et environnementaux faibles.
Un espèce « ingénieure des écosystèmes » est un organisme qui modifie de façon importante son environnement au point d’avoir un impact significatif sur d’autres espèces soit directement par leur simple présence comme les arbres dans les forêts, soit par leur activité sans que cela soit en lien avec leur biomasse comme par exemple l’action des castors sur nos rivières. Voici ce qu’en dit Thierry Dutoit ici
Dans la plaine de Crau, suite à une fuite d’hydrocarbures et un transfert de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de sol, nous avons testé la réintroduction de fourmis moissonneuses (Messor barbarus L.) afin d’accélérer la restauration de la végétation steppique qui préexistait (lien). Après une dizaine d’années, nos résultats ont montré une grande réussite de l’opération avec des résultats très favorables, là où des nids se sont formés suite à la transplantation, notamment sur la fertilité du sol, la biomasse herbacée, la composition et la richesse spécifique de la végétation qui sont alors beaucoup plus proches de la steppe de référence (lien). Thierry Dutoit et Tania de Almeida expliquent cette recherche ici et là.